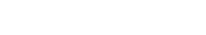La frontière salvatrice. Espagne, asile et refuge pour les Marocains. Le Maroc, refuge et asile pour les Espagnols
Dans le cadre du IIIe Congrès international : « Le Maroc et l'Espagne dans le contexte méditerranéen », qui se tiendra à l'Université Moulay Ismail de Meknès. L'Institut Cervantes de Fès participe de la main du professeur et historien espagnol Eloy Martin Corrales avec une conférence intitulée : La frontière salvatrice. Espagne, asile et refuge pour les marocains. Le Maroc, refuge et asile pour les espagnols. Au cours des six derniers siècles, le Maroc et l’Espagne ont été respectivement des terres de refuge pour les Espagnols et les Marocains. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, les espagnols étaient nombreux au Maghreb en général et au Maroc en particulier, certains cherchaient à sauver leur vie, tandis que d'autres aspiraient à une promotion sociale et/ou économique qu'ils ne pourraient pas obtenir dans leur pays d'origine. Ce sont les renégats, les soi-disant « chrétiens d’Allah », qui ont abandonné le christianisme pour embrasser l’islam. Entre 1767 (date de la signature du premier Traité de Paix, d'Amitié et de Commerce entre les monarques espagnols et marocains) et 1859-1860 (Guerre d'Afrique), tout semble indiquer que les renégats furent dépassés par les « Pasados al moro ». » (Fuites des places espagnoles sur la côte nord-africaine), dont beaucoup ont renoncé, même si la majorité ne l'a sûrement pas fait. Presque parallèlement, entre 1823 et 1909, un groupe important d'espagnols s'opposant aux différents gouvernements qui se succèdent dans la péninsule s'enfuit : libéraux de Tanger (1823-1835), carlistes (à partir de 1833), progressistes radicaux (à partir de 1833). ), anarchistes et ouvriers révolutionnaires (depuis 1848), républicains et cantonalistes (depuis 1873). Le cas des Marocains, bien que moins connu et moins travaillé que celui des Espagnols, entretient avec lui un parallèle étroit. Au cours des trois siècles mentionnés, les « musulmans du Christ », renégats de la rive sud, ne manquèrent pas. Au cours des XIXe et XXe siècles, nous constatons que de nombreux Marocains ont fui l'Afrique du Nord pour différentes raisons. Mais ses aventures, presque toujours seul, ont rendu ses études difficiles. Bien que le groupe le plus visible soit celui des Algériens, les Mogataces ou « Maures de la paix » algériens d'Oran, qui ont préféré partir pour Malaga, d'abord, et Ceuta, ensuite, pour sauver leur vie en danger pour avoir combattu aux côtés des Espagnols contre d'autres Algériens. Aussi, ceux qui, après l'indépendance du Maroc, ont cherché refuge en Espagne (parmi les exemples, celui d'un des fils de Raisuni). I.